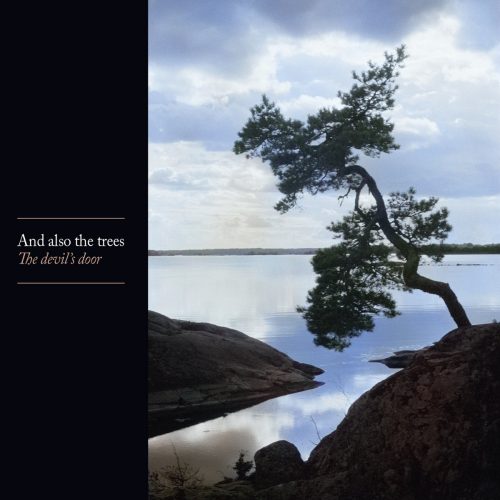Dans la chaleur du Chair de Poule, le légendaire guitariste américain, Sir Richard Bishop, a livré un moment suspendu, entre mystique et virtuosité brute.
Je n’ai d’abord perçu que le haut d’un chapeau, l’extrémité d’un coude. Puis je n’ai plus rien vu, dès lors que j’ai fermé les yeux. Je suis arrivé à l’heure dite, 19h30, mais le Chair de Poule, bar underground et fabuleux sis rue Saint-Maur dans le onzième arrondissement, est déjà plein comme un œuf.
Je me cale au fond à gauche, près du flipper « Metallica » et, après avoir enregistré une vision fugitive du visage pénétré et sillonné de rides de Sir Richard Bishop, saisi au vol un éclat du bois éreinté de sa guitare acoustique, je ferme les yeux. Des mystères de ses accords, de la sorcellerie de ses rythmes, des pleins et déliés de ses arpèges, je renonce à percer quelque secret. Des chemins qu’empruntent ses doigts vagabonds, je ne saurais rien. Du corps de l’Américain (que je devine) massif, aux prises avec son instrument, je n’aurai aucune idée. Ne resterait alors, une heure et quart durant, que la musique, jaillie de la seule guitare folk de Bishop, soutenue en de rares occasions par son chant de vieil Indien.

Par la puissance de sa vision, Bishop parvient à fondre en un même creuset la science d’un jeu virtuose avec une sonorité immédiate, brute, sans apprêt. La musique est interprétée comme on joue avec le feu : sitôt avivé, l’homme, de ses mains caleuses, en tire les braises pour les faire danser dans l’atmosphère saturée de la petite salle parisienne. Forgeron, jongleur, arpenteur, orpailleur, cavalier, éclaireur – Bishop est tout cela et tant d’autres choses à la fois. Ses morceaux, emplis de silences ou d’échos, bientôt saturés de notes et de vibrations, sont son seul langage. Du concert, il ne dira presque aucun mot – même son chant s’expulse en onomatopées. Sa voix est délivrée de sa cage thoracique telle un oiseau dont les ailes engourdies peinent d’abord à se déployer, puis que rien ne semble pouvoir arrêter sitôt l’élan trouvé.
Quelques semaines auparavant a paru, sur le label chicagoan Drag City, l’album Hillbilly Ragas, vingtième disque environ de l’artiste et parfait ambassadeur du concert livré ce lundi d’automne à Paris : de la guitare et de la guitare seulement, sans ajout de pistes, sans artifices de studio. De la musique saisie au vol, captée en l’aller simple et fraîchement tracé qui la conduit du musicien à l’auditeur.

À mi-chemin entre la musique enracinée des pionniers, qu’ont explorée en tous sens les « primitivistes » américains auprès desquels Sir Richard Bishop compagnonne inévitablement, vivants ou morts – John Fahey (sur son label Revenant avait paru en 1998 le premier album de Bishop), Robbie Basho, Glenn Jones – et un lointain Orient. La manière dont Bishop s’empare des modes indiens du raga et embrasse leur mystique appelle l’esprit d’un autre guitariste américain à la tendresse renversante, Peter Walker. Mais peu importent références ou comparaisons : pour la centaine de spectateurs entassés, heureux, dans la chaude enceinte du Chair de Poule, connaisseurs hardcore ou novices absolus (et il y avait les deux), ce qui s’est joué ce soir-là l’était pour la première fois.
Chacun est reparti avec, coincé au fond de la poche, un petit bout de charbon au cœur ardent, puisé à même un flanc des Appalaches et, sur la joue, le souvenir de la caresse d’un colibri du Gange. Moi qui n’ai rien vu, je découvrirais quelques précieux fragments du concert grâce aux photographies de Julien Courbe, habitué du lieu qui, sur le baryté photographique, sait toujours coucher le grain de la musique. En un processus de révélation plus fraternelle que chimique, le visage de Bishop m’est alors apparu, ainsi que sa guitare et le contour, moins massif que je ne l’avais imaginé, de son corps. Au charbon de montagne et au souvenir de la plume est venue s’ajouter une poignée de tirages en noir et blanc.