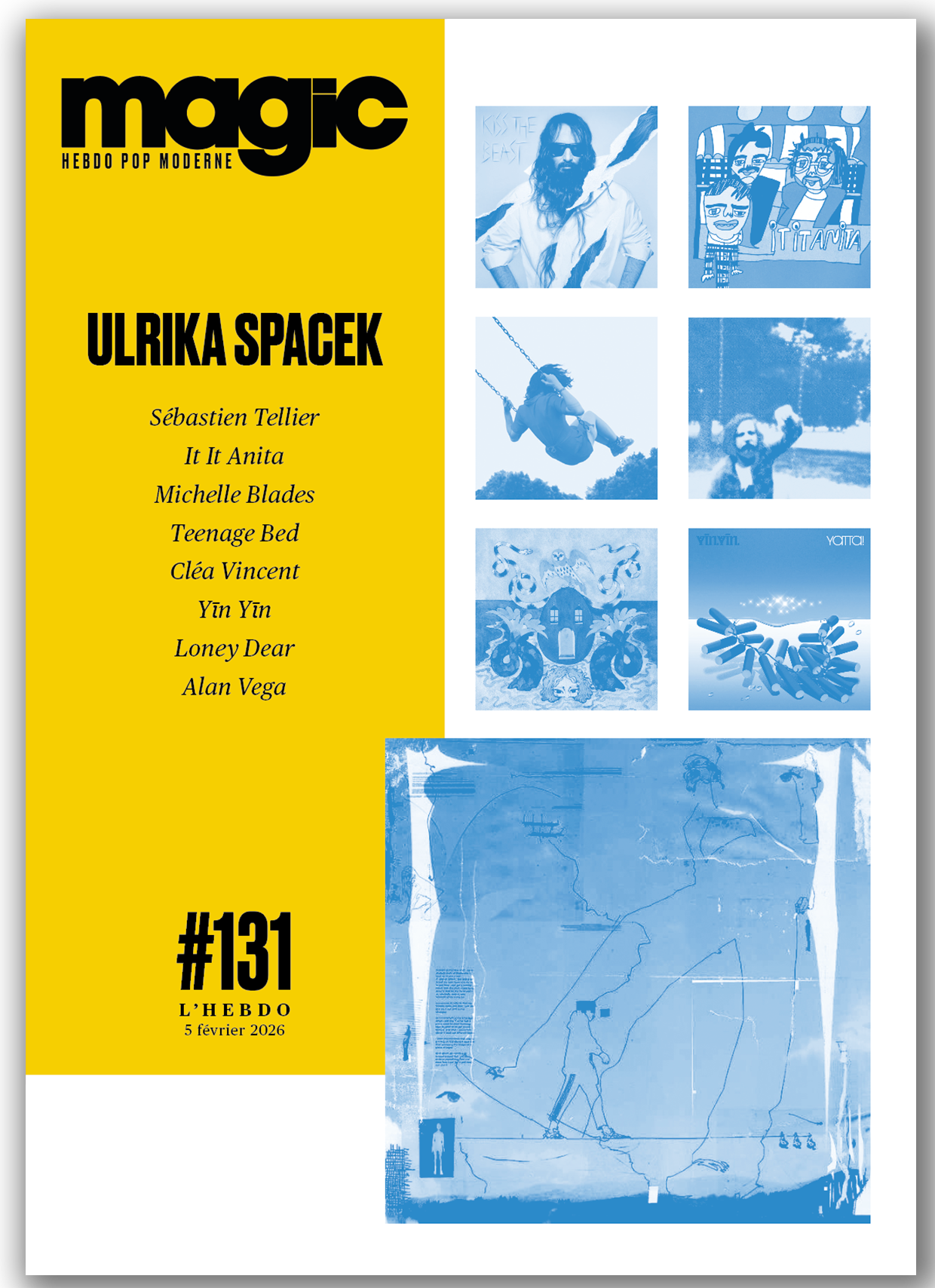Devant un Studio de l’Ermitage comble, Christine Zayed célèbre enfin "Kama Kuntu", son premier album, six mois après sa sortie. Une traversée musicale bouleversante, entre mémoire intime, exil palestinien et poésie vivante.
Le Studio de l’Ermitage est plein à craquer : la coursive comme la salle, les places assises comme chaque espace du parquet lessivé de ce lieu bien connu des amoureux de jazz, de musiques de traverses et d’ailleurs, situé à deux pas de la rue-monde de Ménilmontant. Il semblerait que Christine Zayed et ses musiciens ne soient pas les seuls à avoir attendu fiévreusement ce moment.
Kama Kuntu (que l’on peut traduire par « Ce que j’étais »), le premier album de la Palestinienne, est paru il y a six mois déjà ; si la musicienne s’est beaucoup produite depuis, c’est le plus souvent pour d’autres projets que le sien propre. Ce soir, c’est Kama Kuntu que l’on joue et célèbre, ce si beau disque qui fait son chemin, cueillant les auditeurs les uns après les autres pour ne plus ensuite les lâcher.
Christine est assise au centre de la scène – silhouette menue, épaules ceintes d’une étole, et son qânun qui repose sur ses genoux. Cette cithare millénaire, depuis qu’elle en a entendu la sonorité dans son enfance puis s’est mis en tête d’en percer les mystères, ne la quitte plus. Elle est le véhicule de ses voyages immobiles, le moteur de ses rencontres musicales, la trappe secrète qu’elle emprunte pour retrouver les fragrances et les murmures, la lumière et les voix de son pays, la Palestine.
Avant que le concert ne commence, tandis que toute l’équipe dînait à quelques mètres de là, Christine était restée seule avec Bilal – c’est ainsi qu’elle l’a prénommé, cet être de bois et de peau – afin d’en accorder chacune des soixante-dix-huit cordes. Il se passe toujours, avant qu’ils ne retrouvent la compagnie des musiciens et le flot des spectateurs, ce moment entre elle et lui.
Le concert s’ouvre par un long morceau instrumental, « Jeudi, 16h53 », moment exact de la naissance de Christine, entame de son chemin existentiel et de celui qu’elle s’apprête à faire avec nous. À sa droite, Sylvain Barou, présent déjà sur le disque, joue de différentes flûtes (ney, bansouri, duduk) ; à sa droite, l’Iranien Habib Meftah danse derrière son set de percussions.
Puis Christine salue l’audience. En arabe, en français, puis en anglais.
« Ce sont les trois langues que je connais, je n’en connais pas d’autre ! Enfin, si, je connais l’hébreu des checkpoints », lâche-t-elle, en un rire nerveux.
Ce sera l’une des deux seules allusions à la tragédie que traverse son pays ; celle-ci ne quittera de toute façon jamais vraiment les esprits réunis autour d’elle ce soir.
Sitôt après, elle se saisit de son carnet rouge, dans lequel sont consignées ses pensées, notes et poésies, pour y puiser la traduction en français du poème de Hussein al-Barghouti, « Safartu », qui lui a inspiré la chanson qui ouvre son album :
Tu as choisi de partir sous la lune argentée
Laissant mon cœur sur les marches
Brillant comme une épingle d’argent
(…)
J’aurais tant voulu que tu l’emportes dans tes bagages.
La douleur de l’exil s’avancera sous les atours de la blessure amoureuse. C’est de poésie et de musique qu’il s’agit, suggère Christine Zayed, d’art et d’amour, et c’est dans ces parages-là que son trio emmènera la salle jusqu’au bout du concert. Une heure quarante-cinq d’un voyage : ses ascensions, transes et redescentes en bulles légères, ses gorges nouées et ses soupirs, ses rires aussi, et les larmes qui viendront, inexorablement.
L’album Kama Kuntu invite, aux côtés des percussions traditionnelles et du qânun, les sonorités rock et contemporaines des guitares de Piers Faccini, ainsi que les touches d’étrangeté intraçables de l’orgue de barbarie d’Alexis Paul, et les racines baroques et européennes de la viole de gambe de Marie-Suzanne de Loye.
Au Studio de l’Ermitage, ce soir de mai, la musique se resserre autour du Moyen-Orient.
Les minutes passent et la température des lieux monte.
« Peut-être fait-il trop chaud pour entonner une chanson d’amour », sourit Christine, avant d’attaquer la magnifique « Gharimi ».
Auparavant, elle aura égrené les titres de son disque, transfigurés, ramenés à l’os, couverts de la poussière amenée par le khamsin du Levant jusqu’à Paris – souffle tiède des flûtes et sécheresse rocailleuse des percussions.
Quelques titres moins connus se glissent :
– « Un jeudi pour Darwin », composé pour le film de Mathieu Baillargeon, contant l’histoire de Jack, victime d’une fracture empathique : l’impossibilité de ressentir des émotions, un comble lors d’un concert tel que celui-ci.
– « Mariam », chantée lors des mariages et offerte ici en une version bouleversante.
– Et « Ya Taalaeen », une chanson que les femmes palestiniennes, sous l’occupation britannique, pressées contre les murs des prisons, chantaient à leurs aimés incarcérés.
Pour être comprises d’eux seuls et non de leurs geôliers, elles encodaient les paroles en ajoutant une syllabe entre chaque mot. Christine explique cela, avant d’entamer la mélopée – l’une des acmés du concert.
Au fur et à mesure que la pâte de la musique s’épaissit, du qânun de Christine s’échappent des fragments d’enfance : les voix chantantes de ses grand-mères, l’odeur terreuse des figues et celle, épicée, du café, le bruit de sa petite balançoire, les mélodies mouillées des feuilles de bigaradier, l’appel lointain à la prière aux petits matins, la danse des cerfs-volants dans le bleu silencieux des ciels sans bombes, les oiseaux qui dansent à flanc de montagne au printemps, ses pas rapides lorsqu’elle court pour cueillir sa fleur préférée : le coquelicot.
Ce sont ses souvenirs qu’elle partage par le truchement de ses chansons, sa douleur qu’elle transfigure en la beauté d’un instant partagé, grâce au pouvoir alchimique de la musique.
Ce sont nos souvenirs, singuliers, intimes, qui remontent aussi – chacun, dans la salle, se saisira d’une note, décochée telle une flèche en plein cœur, pour faire saigner ce qui devait saigner, ouvrir ce qui devait s’ouvrir.
Chacun est rappelé aux parfums, aux voix, aux sons et aux couleurs de son propre pays, réel ou imaginaire.
Une heure de concert a passé et la nervosité qui l’habitait, dès lors qu’elle cessait de chanter ou de jouer, semble l’avoir totalement quittée.
Christine Zayed demande :
« Vous êtes d’accord pour rester encore un peu en Palestine ? »
C’est une question-sourire, un appel léger qui recèle toute la profondeur de ce qui se joue entre elle et nous.
Une invitation.
Oui, tout le monde est d’accord.
Son pays est, ce soir, notre foyer commun,
une terre paisible,
le passé, le présent et l’avenir enfin réunis.