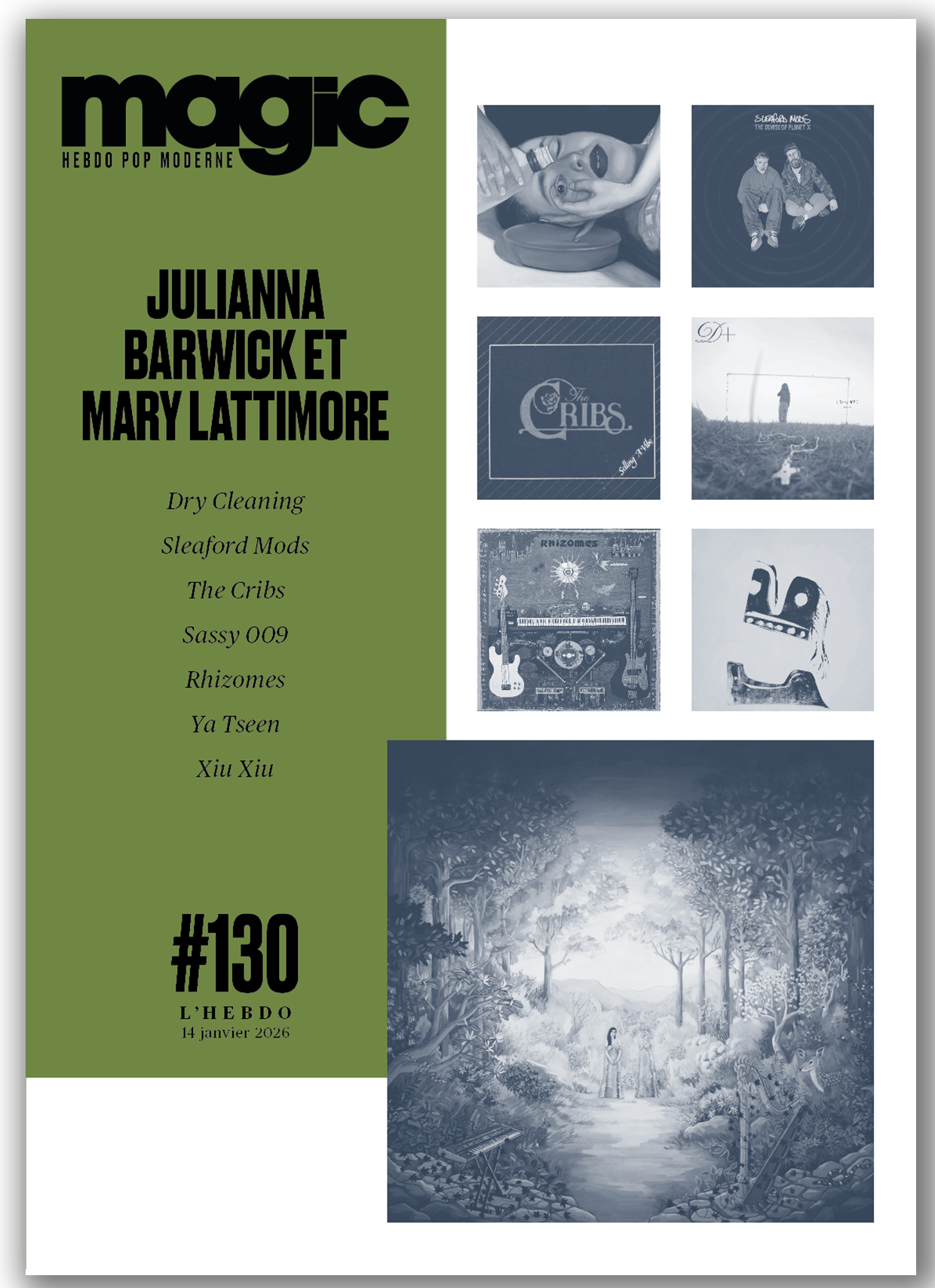COOTIE CATCHER
Shy at first
(COOKED RAW) – 14/03/2025

Je l’avoue : je me fais souvent avoir par le marketing. « Oh, un truc avec des Pokémon sur le paquet ? Bon, je n’ai pas besoin de mort aux rats, mais j’aime bien l’emballage ! Je prends ! » Alors, quand, en me baladant dans le catalogue du diable en personne – mon boycott de Spotify a tenu cinq jours, j’en ai un peu honte –, je suis tombé sur un groupe avec à la fois un nom mignon et une pochette adorable, il fallait évidemment que j’écoute. Pour une fois, le packaging était aussi intéressant que ce qu’il contient. Cootie Catcher – qui se contente d’un “say hi” en guise de biographie –, originaire de Toronto, déploie sur son deuxième album Shy at first une pop lo-fi enfantine, du genre à se cacher dans un coin de la maison pour éviter d’aller saluer les invités – de peur qu’ils ne nous mangent ou, pire, ne nous demandent où en est notre recherche d’emploi.
Shy at first porte d’ailleurs parfaitement son nom. Du moins, au début. Ses deux premières minutes prennent la forme d’un collage de samples accélérés, rembobinés, tarabiscotés, à peine soutenus par une boîte à rythmes toute discrète. En fond sonore, on croit même entendre ce qui ressemble à un tutoriel qui vous engueule parce que vous n’arrivez pas à faire un nœud coulissant alors que vous débutez à peine le crochet. Et puis tout s’emballe un peu, comme un introverti quand on touche à sa corde sensible. Ici, tout déborde de claviers plus régressifs que la sensation qui vous envahit lorsque vous vous approchez d’une boutique Lego. Cootie Catcher – c’est d’ailleurs le nom américain des cocottes en papier – donne en effet l’impression d’avoir ouvert un gigantesque coffre à jouets pour en extraire à la fois les bruits les plus étranges et les mélodies les plus chatoyantes. Et s’il vous en manque, des mélodies chatoyantes, les guitares, avec juste ce qu’il faut de saturation, sauront aussi vous éblouir. Dans une pure veine twee pop 2.0 – il n’y a qu’à se laisser happer par les voix toutes mignonnes d’un quatuor qui se partage le chant comme un paquet de bonbons –, Shy at first regorge de certaines des tracks les plus attachantes de 2025 – Words mean less, Dumb lit, If it’s in Vogue, Galleria ou encore Musical chairs. Dire qu’un nouvel album est déjà prévu pour 2026…
Jules Vandale ••••°°
ACOPIA
Blush Response
(SCENIC ROUTE RECORDS) – 12/09/2025

Scenic Route Records. Voilà un nom de label parfaitement approprié pour accueillir en son sein un groupe aussi vaporeux qu’Acopia. Vaporeux ? Il ne suffit que d’une seule écoute de Blush Response pour comprendre qu’on tient là un album qui boxe dans la même catégorie que Luster, le récent chef-d’œuvre de Maria Somerville, ou que l’a.s.o du groupe du même nom, paru en 2023 – mieux encore, Blush Response en constitue un parfait point d’équilibre, quelque part entre les deux. D’a.s.o, il emprunte cette trip-hop raffinée, ce délicat fracas de machines enlacé à des nappes florissantes de synthétiseurs. De Maria Somerville, il retient cet art de la guitare, mimique de shoegaze sans jamais sombrer dans des distorsions absurdes, qui seraient ici aussi hors-sujet que la copie que j’ai rendue au bac de philo.
Blush Response se love dans une léthargie dont on aimerait prolonger les effets – le projet s’achève en moins de trente minutes – tant elle finit par nous contaminer. Et si l’on ferme les yeux, le disque donne presque l’impression de se retrouver au volant d’une moto, dans une nuit seulement éclairée par les néons des rues et les projecteurs blafard d’un tunnel, slalomant sans casque au milieu des klaxons, votre dulcinée sur la place arrière – comme la scène finale de Fallen Angels de Wong Kar Wai, mais qui se déroulerait ici dans un ralenti qui transformerait chaque mouvement, chaque flux de lumière, en pur flou artistique. See You In Everyone est peut-être une des breakup song les plus douces de l’année.
Jules Vandale ••••°°
NATHAN ROCHE
35 Rue du Théâtre
(CELLULOID RECORDS) – 07/10/2025

Une de mes histoires préférées à propos de Nathan Roche est une histoire que je n’ai jamais vue de mes propres yeux – mais je crois dur comme fer la personne qui me l’a racontée. Un jour, alors qu’il jouait avec le Villejuif Underground au Biche Festival, il aurait eu l’excellente idée de grimper tout en haut de la structure métallique où étaient accrochés les projecteurs, laissant l’équipe du festival en pleine panique, déjà en train d’imaginer l’appel aux assureurs. De quoi résumer le caractère imprévisible de cet Australien qui, selon la légende, se serait retrouvé coincé en France il y a une dizaine d’années avant de monter le groupe le plus ingérable du sud-ouest parisien, d’enchaîner recueils de poésie et projets solos toujours plus souterrains, de faire du mannequinat pour Céline, de mettre sa carrière entre parenthèses à cause d’un divorce agité, de voyager aux quatre coins du globe… Bref, de mener une vie bien remplie.
Avec 35 Rue du Théâtre, on quitte pourtant les rues d’un Paris qui sent la pisse. Nathan s’est exilé à Saorge, à quelques kilomètres de la frontière italienne. On l’imagine écrire I’m The Chorus, 35 ou The Shooting à la terrasse d’un petit café dont le demi de bière n’a pas vu son prix évoluer depuis le siècle dernier, se prendre pour un guitar hero dans des décors figés depuis le Moyen Âge – comme il les décrit lui-même dans une interview donnée à Nice-Matin –, chanter Take Me Back en fixant la Méditerranée, espérant y deviner son Australie natale, ou promener sa dégaine d’Apollon de the land down unda tout en sifflotant Bendola ou I Ate The Moutain sur les sentiers de randonnée qui longent la Roya, la rivière locale.
35 Rue du Théâtre voit Nathan Roche faire du Nathan Roche. Et on lui pardonne, parce que c’est Nathan Roche. Le garage rock est mort ? Non : Nathan Roche est toujours là. Et au-delà d’une voix absolument magnétique, de crooner maudit s’il en est, il possède ce « truc » – à la manière d’un Ty Segall ou d’un John Dwyer – qui rend ses morceaux intemporels plutôt que simplement « sortis trop tard dans l’histoire de la musique ». C’est rock’n’roll, rhythm’n’blues, psyché et tous ces genres joués par des hommes aux cheveux grisonnants qui testent des Tube Screamer sur YouTube – faites plutôt du shoegaze les gars, sinon comment je suis censé savoir si j’ai besoin de cette pédale d’overdrive plutôt que d’une autre ? –, mais le tout passé par les mains expertes de l’un des musiciens les plus passionnants de la scène underground française de ces quinze dernières années. Un grand disque, porté par de grandes chansons, encore plus quand il se décide à chanter en français sur deux des titres les plus inattendus de 2025 : C’est inutile et J’en ai marre. Deux qualificatifs qui ne correspondent pas à Nathan Roche.
Jules Vandale ••••°°
JIM E. BROWN
I Urinated On a Butterfly
(DIDSBURY PARSONAGE)

10 septembre 2025. Alors que j’attends mes sushis dans un boui-boui des Lilas avec un ami, celui-ci se met à me raconter le concert qu’il a vu la veille. « Il chante des trucs qui devraient te faire marrer, genre I’m Not Pretty Enough To Be On Tinder ». Ce type trop moche pour la plus célèbre des applis de rencontre, c’est Jim E. Brown. Un mec au physique de pilier de PMU qui, selon sa propre légende, aurait 19 ans mais serait déjà ravagé par la bière, ou bien 24 ans, car né la veille du 11 septembre 2001 du côté de Didsbury, dans la banlieue de Manchester. En réalité – ou pas, puisqu’il reste volontairement flou – il s’agirait plutôt d’un certain Max Margulies, scénariste basé à… Philadelphie. Jim E. Brown a, en tout cas, une vie très triste. Son ex a liké son dernier post Instagram… sauf que non, c’était un rêve. Ouin. Il y a trop de monde chez Gregg’s, son sausage roll devra attendre. Ouin ouin. Bambi l’a fait devenir vegan. Ouin ouin ouin. Il a vomi sur un papillon, puis sur l’autobiographie de Britney Spears. Ouin ouin ouin.
Tout ça n’est pas inventé : ce sont littéralement des traductions de titres de I Urinated On a Butterfly, le dixième album (!) du bougre. Et le pire, c’est que passée la blague, tout se tient musicalement. Son chant un peu flasque – un Morrissey à qui on aurait remplacé le sang par trois litres de Guinness chaude – colle parfaitement à ces chroniques de looser magnifique. Autour, une pop lo-fi très britannique, quelque part entre les Kinks et Charles Bukowski. Tout sonne cheap, un peu comme chez Pleasure Principle par chez nous, mais dans le bon sens du terme. Bon, je ne vais sans doute pas me farcir les neuf autres albums de sitôt, mais de temps en temps, un disque-blague bien fichu, ça fait quand même du bien.
Jules Vandale ••••°°
ANNE LAPLANTINE
Partons pour tu (assemblage 1999–2021)
(FRISSONS CASSETTES) – 07/11/2025
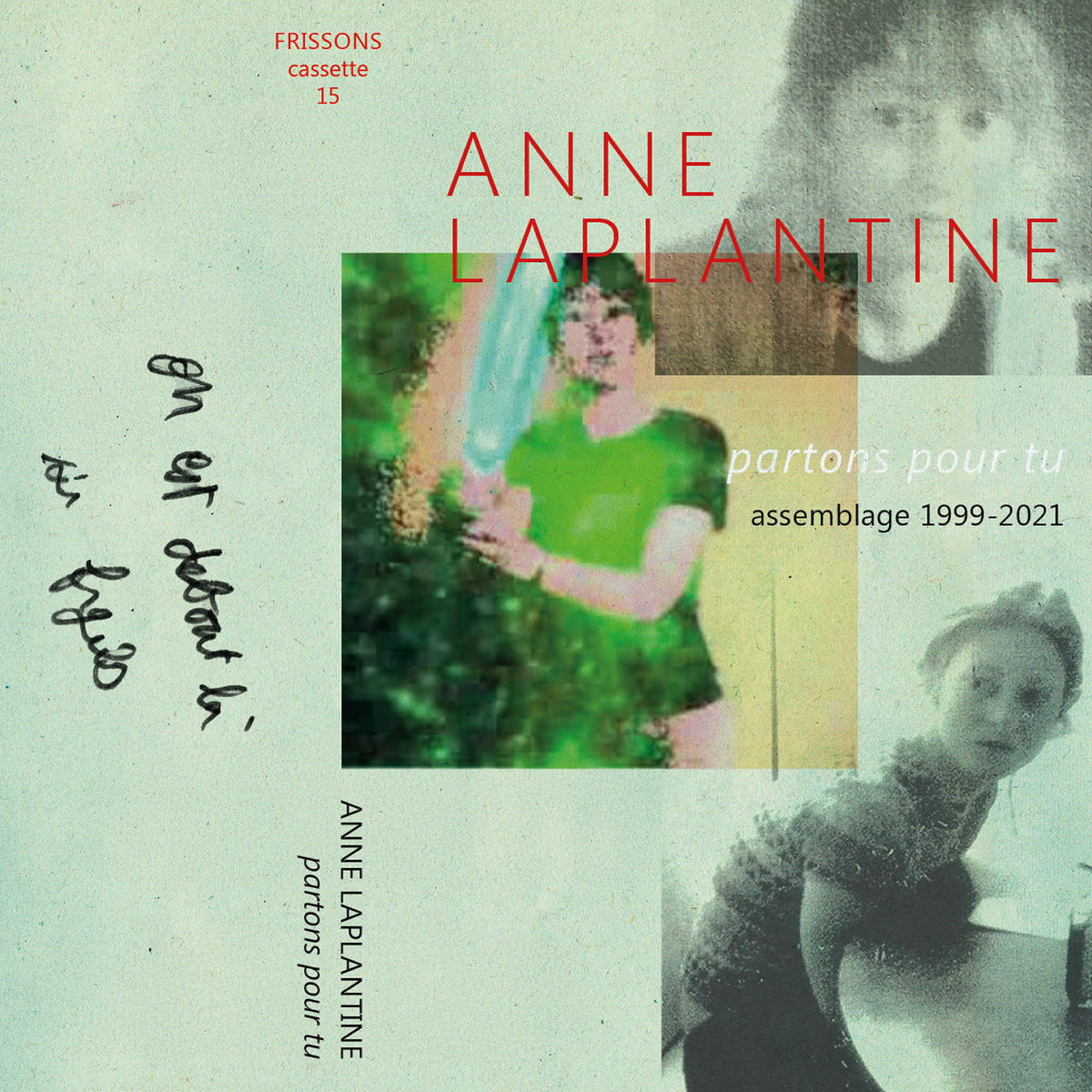
Quand je l’ai rencontrée au début des années 2000, Anne Laplantine aimait nommer ses répertoires du nom des personnes qu’elle n’appréciait pas, pour le simple plaisir de pouvoir lire sur son écran, lorsqu’elle mettait ces dossiers dans la corbeille : « Voulez-vous définitivement supprimer… [remplir du nom de l’intéressé] ? ». Elle avait aussi créé pendant plusieurs mois un petit label, Nordheim, aux références hebdomadaires mais aux tirages limités à cinq cassettes par semaine. À cette même époque, dans les magasins de disques parisiens, on pouvait régulièrement trouver des flyers personnalisés pour ses prochains live : en fait, des tracts de concerts où le nom de l’artiste mis en avant avait été biffé, remplacé au stylo par « Anne Laplantine »… C’est ainsi que cette jeune femme aux mille idées par minute les concrétisait, spontanément, dans une certaine urgence légère qui rendait tout ce qu’elle abordait extrêmement poétique et touchant.
Urgence et légèreté, ces deux mots reflètent assez bien aussi, il me semble, la musique d’Anne Laplantine : instrumentales (arpèges mélodieux ou aléatoires de synthétiseurs cheap, basslines electro sinueuses, fragments de boîtes à rythmes 80’s, guitares, banjos, flûtes légèrement out of tune, cuts & pastes, starts & stops, glitches et clics, souffle de la bande, bruits de la vie), ou chantées d’une voix indistincte (haute, ténue, fragile, diaphane, lointaine, filtrée, translucide, quasi fantomatique), ces ritournelles synthétiques épurées esquissent sur la bande magnétique ou la piste numérique les instantanés évanescents d’une appréhension musicale du quotidien. Entre electronica lo-fi, minimal wave, vaporwave, synthpop baroque ou musique – littéralement – de chambre, le répertoire d’Anne Laplantine ressemble à un journal intime sonore, clair et pâle comme un matin d’automne, comme désireux de fixer chaque jour écoulé en une lumineuse lutte contre la fuite du temps. « Je trouve que la musique est là pour porter une attention au temps », expliquait la musicienne dans une interview de 2022. « Et il n’y a peut-être plus grand-chose qui donne une attention aux instants, aux choses microscopiques. Socialement, on est inattentif au temps. »
Depuis la fin des années 1990, Anne Laplantine n’a jamais cessé d’égrener le temps qui passe, entre gaieté et mélancolie, nous invitant à compter les jours avec elle. Avec cette compilation, le label bruxellois frissons cassettes nous invite à son tour à explorer et redécouvrir cette musique délicate et erratique en 29 morceaux piochés dans la discographie pléthorique d’Anne Laplantine, publiée sur son site (on y trouvera les répertoires « unreleased », « poubelle » ou « soundcloud ») ou via de nombreux labels de la scène underground européenne (Gooom Disques, Tomlab, Emphase, Et mon cul c’est du tofu, Lexi Disques, Midi Fish, Cudighi Records…). Pop abstraite, vignettes synthétiques, éclairs électroniques, micro-chansons, coqs-à-l’âne et accidents, la musique d’Anne Laplantine est pleine de mystères. « À beaucoup de bruit, beaucoup de spectacle, je vais préférer quelque chose qui va être un secret. Si quelqu’un tombe dessus, bah il aura de la chance », dit Anne Laplantine. Vous en avez de la chance.
Wilfried Paris ••••••
YOUNA PNEUS
Anti Gaspi
(NICHE NICHE MUSIQUE) – 21/09/25

Pour ce troisième volet du never‑ending hommage au collectif culte parisien Youna Pneus (après les excellentes compilations de reprises Entretien Auto (2022) et Contrôle Technique (2024), on ne change pas les bonnes habitudes : c’est encore le folk dépouillé et érudit de Norman Would qui ouvre le bal. Avec un concept singulier : reprendre, encore une fois, le mythique Amortisseur, mais dans la version 2022 de Trotski Nautique, brute et magnifiquement fataliste. Le reste est plus âpre, exigeant et expérimental, oscillant entre la techno sale de The Marquis Is Dead, celle plus lumineuse de In My Head (dans un registre très étonnant pour ces adeptes de rock indé), l’indus presque parodique de Bolshevik Intervention, la pop revisitée de l’américaine Wawa Dupont, le hardcore de AVC, la new wave lumineuse de Cold Cause (ex‑Shoemale67) et même le rockabilly de Pierre Karapetianz.
Tous styles no‑art donnant, à leur mesure, une idée du legs immense de Youna Pneus sur la scène garage rock contemporaine et laissant imaginer d’autres hommages encore, nationaux et internationaux. À noter, le featuring inédit de Niko de Youna Pneus sur le martial et dansant Périphérique de L’Ecuyer. Prémices d’une réapparition inespérée et pas d’une peine perdue ? De quoi filer la chair de poule…
Julien Courbe ••••°°
CORDIALEMENT
B-sides and Rarities
(AUTOPRODUCTION) – 30/10/25
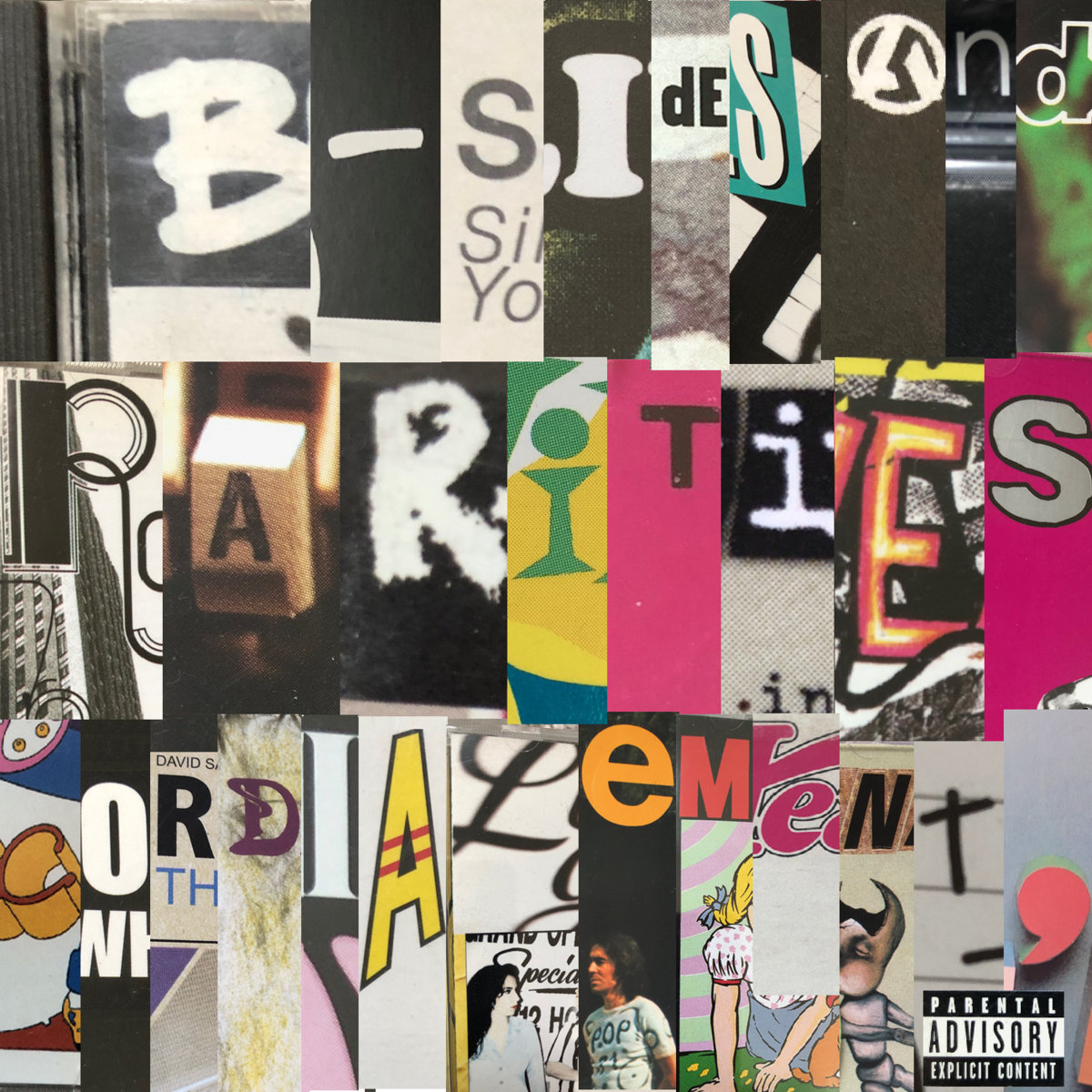
Huit morceaux enregistrés en quatre jours, esthétique et son hardcore, et un titre en forme de blague : ces B-sides and Rarities sont de vraies faces A, fières et dignes des pontes du genre. Jeunes « vétérans » des scènes noisy (notamment bordelaises), les trois Cordialement ressuscitent le son nineties et les souvenirs des groupes de l’antichambre grunge (l’excellent Roomate), Fugazi en ligne de mire.
Autobiographique, le disque raconte des moments de vie fondateurs (The Dreambreakers) ou salvateurs (le Time to Let Go final, très Nada Surf, très enthousiasmant), en de courtes minutes urgentes, mélodiques et érudites, follement revigorantes. Pour les fans de Cop Shoot Cop, Unsane ou The Jesus Lizard qui n’auraient pas perdu la foi… « Sun is out, and the path is pretty / Truth is somewhere but I forgot ». Pas nous, on se souvient toujours des musiques essentielles de nos vies…
Julien Courbe ••••°°
JEAN-BAPTISTE LOUSSIER WITH JODY STERNBERG
Back to Bach
(APARTÉ) – 17/10/2025

Enfant de la balle, Jean-Baptiste Loussier a été bercé par les reprises jazz de Bach de son père Jacques Loussier, autant que par les sessions d’enregistrement de Pink Floyd, The Cure ou Sade au Studio Miraval. Précoce, il enregistre à treize ans sa première bande son avec le London Symphony Orchestra et, depuis trente ans, compose pour le cinéma et la télévision ou accompagne sur scène des artistes comme Dani. À 62 ans, il sort aujourd’hui Back to Bach, un album d’électro-pop mélancolique où il revisite Bach en compagnie de son amie Jody Sternberg (ex-Morcheeba), qui apporte au projet sa voix mutine, ses textes et un soupçon de folie douce. Si, à l’instar de Rosalía, il mêle pop et musique classique, Loussier convoque ici les fantômes du passé, et chaque titre fonctionne comme une poupée russe remontant le temps. On passe de la langueur trip-hop 90’s d’un Perry Blake à la légèreté des musiques de film des années 80 de Vladimir Cosma, en passant par l’élégance 70’s de Jean-Claude Vannier ou Serge Gainsbourg, sans jamais oublier l’élément central du projet, le GOAT Jean-Sébastien Bach. Le célèbre Aria devient Dreams, pépite vaporeuse et titre phare de l’album, le suave Dancer s’inspire d’une cantate de Bach, tandis que Sun & Fun invite carrément Jean-Seb à venir guincher sur le dancefloor.
Les arrangements, d’une précision d’orfèvre, puisent aussi bien dans les pages les plus célèbres que dans des œuvres plus confidentielles de Bach, déplacées avec une liberté pleinement assumée. Instruments acoustiques et textures synthétiques s’entrelacent sans hiérarchie, donnant naissance à une musique hors du temps, capable pourtant de circuler avec aisance d’une époque à l’autre. Loussier trouve ici un point d’équilibre, et s’autorise à emmener ces pièces loin de leur écrin d’origine, à les métamorphoser en chansons pop à part entière, sans jamais tomber ni dans l’ironie facile ni dans le respect muséal.
Sur scène, Jean-Baptiste Loussier prend le temps d’expliquer sa démarche, jouant parfois au piano la version originale d’une œuvre de Bach avant d’en dévoiler la relecture à venir, comme on passerait de l’esquisse au tableau final. À ses côtés, Jody Sternberg apporte une légèreté bienvenue : sourire ravageur, présence ludique et pas de danse délicieusement absurdes. Elle incarne cette fantaisie qui empêche le projet de se figer dans l’exercice de style et lui donne, au contraire, une chaleur profondément humaine. Cet objet hybride, hommage aux pères, biologiques comme musicaux, rappelle qu’en musique, tout n’est finalement qu’affaire de filiation, de transmission et d’ornementation.
Franck Narquin •••••°