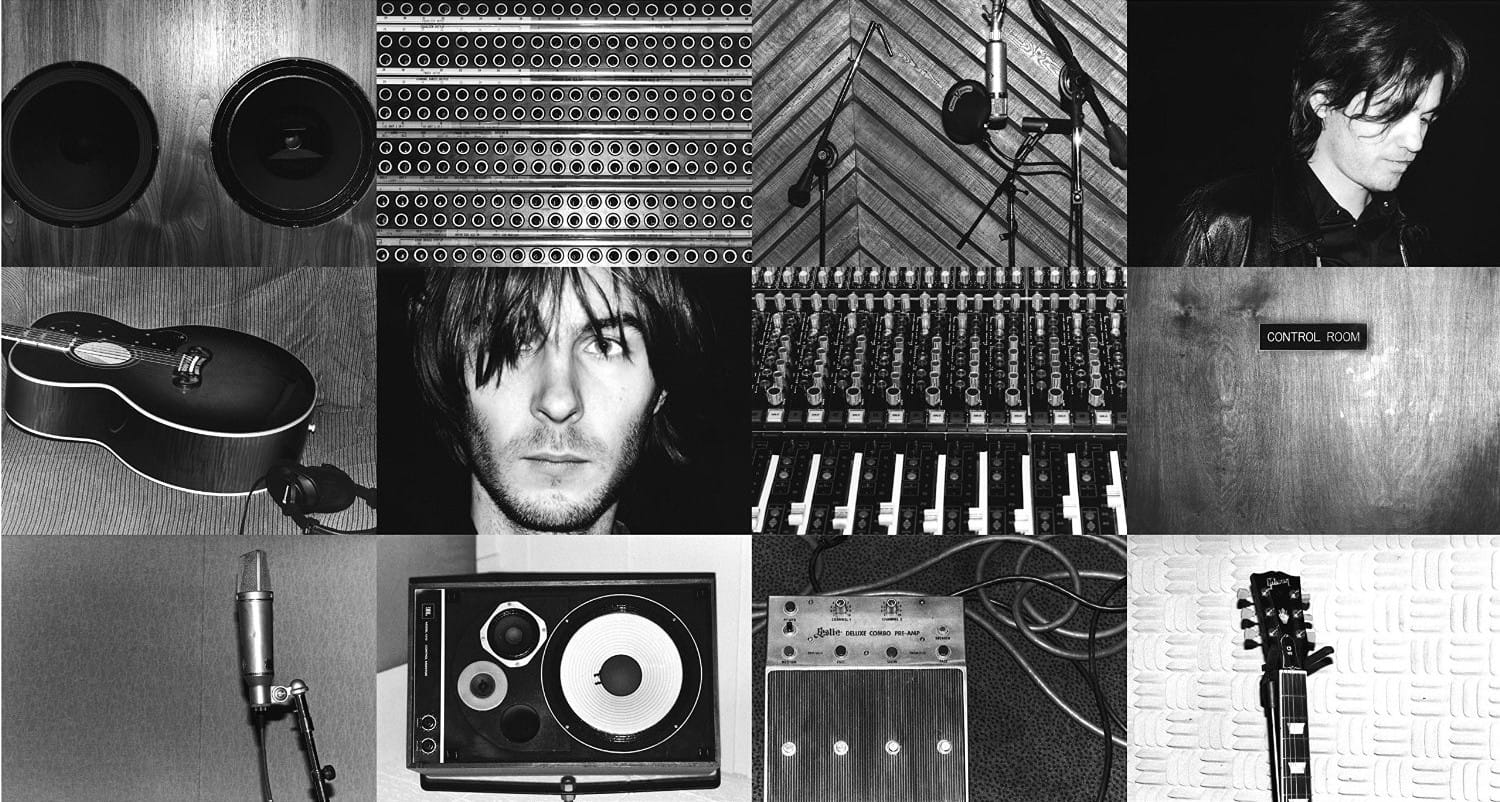Tantôt espoir national, tantôt boysband sans saveur, Phoenix divise depuis le début de son règne en 2000. Car c’est bien un règne discret mais indéniable auquel ont accédé Thomas Mars, Deck D’Arcy, Laurent Brancowitz et Christian Mazzalai à la sortie de United, inusable véhicule d’une pop fraîche et décomplexée. Mais la gloire n’était pas exactement au rendez-vous de ces rois sans couronnes, partis entre-temps errer vers d’autres terres pour mieux reconquérir leurs sujets. Inutile de dire que leur retour au pays s’est fait sans heurts, comme en témoigne leur toute dernière déclaration énoncée par ordre Alphabetical, où le R (de r’n’b) et le H (de hip hop) le disputent à l’évidence du P (de pop limpide). Ambitieux et ingénieux, ce deuxième album éloigne un peu plus encore ses auteurs de leur image de branleurs parvenus. Car de toute évidence, c’est à la lettre G qu’ils seront désormais associés. G comme Génies.
INTERVIEW Estelle Chardac et Franck Vergeade
PARUTION magic n°79Branco : Qui a osé faire ça ? (Sourire.) The Diff’rent Strokes ?!
Christian : Tu peux laisser encore un peu…
Thomas : Je préfère largement l’original. Ça, ce n’est pas quelque chose que j’écouterais.
B : Personne n’écouterait ça ! (Sourire.)
T : En revanche, c’est parfait pour un blind-test. D’ailleurs, on a tous souri. Contrairement à nous, les Strokes ont enregistré rapidement leur deuxième album, qui n’est pas très différent du premier.
C : Je ne demande pas à ces types de révolutionner la musique. Je leur demande simplement d’écrire de bonnes chansons. D’accord, c’est tout le temps la même, mais quelle putain de chanson…
T : Une des meilleures du monde !
B : Les morceaux des Strokes dépassent leur style. Ils sont tellement puissants qu’ils se suffisent à eux-mêmes.
C : Sur Room On Fire, il y a une mélancolie, un truc à la Sam Cooke très 50’s.
T : C’est peut-être la différence majeure avec Is This It, qui s’entend notamment sur Under Control. J’imagine que les prochains morceaux des Strokes seront encore plus lents, à l’avenir.
B : Et toi, Deck ?
Deck : Bah, rien. (Rire général.) Quoi, c’est pas marrant !
B : Avec Alphabetical, on a l’impression d’avoir fait quelque chose de complètement différent. On s’est même surpris. Je ne sais pas comment les gens le percevront…On a piqué l’intro pour Victim Of The Crime, non ? C’est vrai qu’on est fan de Dre. A genius… Je ne pensais pas à ce morceau en particulier mais là, il me revient en pleine gueule. (Sourire.)
D : Cela dit, on assume à mort la comparaison.
C : De toute façon, on n’a écouté presque aucun disque pendant l’enregistrement de l’album.
B : Si je me souviens bien, on voulait un beat qui soit du Dre joué par Ringo Starr. Mais on a bien le droit de le chourer, vu le pilleur que c’est ! D’ailleurs, on fait désormais de la musique pour être samplés. (Sourire.) Toutes nos intros sont conçues comme ça. Et cette fois, il n’y a aucun sample sur l’album. C’est un challenge de faire sonner un disque sans utiliser le génie des mecs qui étaient là avant toi.
C : Nous, on imagine neuf singles possibles dans Alphabetical. Il n’y a aucun morceau d’album dessus.
B : Même I’m An Actor, la face B de Everything Is Everything, je la verrais bien en single. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde l’entende de cette oreille-là. (Sourire.)
T : C’est le morceau le plus violent du disque.
B : En réalité, on est assez nuls pour parler de notre musique. On fait les trucs, et puis après… (Sourire.)Rob Don’t Kill Jack Lahana (Short Version)
C’est cool que vous passiez ce morceau-là. C’est comme s’il était passé inaperçu.
T : Vous avez entendu le remix de Everything Is Everything par Jack Lahana ?
B : Il est vraiment bon, ce Jack.
C : Quand il bosse avec Rob, ils forment un mariage assez unique. En ce moment, ils travaillent ensemble sur l’album de Jack.
T : On avait fait un remix de Never Enough pour Rob, mais il n’est
jamais sorti. La faute à la malchance, sûrement.
B : On est toujours prêts à rendre service. (Sourire.) C’est marrant de faire des remixes, il y a ce petit côté exercice de style qui est assez agréable.
T : Aujourd’hui, on demande très peu de remixes. On préfère offrir des versions démos ou inédites.
B : C’est cheap d’en demander automatiquement pour des singles. D’autant qu’on n’est pas du genre à choisir sur une liste les remixeurs du moment. C’est plus naturel de demander à nos potes, mais on a épuisé l’ensemble de nos connaissances. (Sourire.) On a bien pensé à s’autoremixer, mais ce n’est pas une bonne idée. Il faut savoir s’arrêter. D’autant qu’on n’a pas trop de mal à savoir quand tout est fini. C’est plutôt pour arriver à ce moment-là que c’est difficile. (Sourire.)
C : Pour Alphabetical, on a seulement laissé un morceau de côté.
B : C’est une chanson avec des cordes : la plus chère de notre carrière. (Sourire.) Elle jurait trop avec le reste de l’album. Et puis il y a un certain plaisir à casser son plus beau jouet.Il faut dire le nom à chaque fois ? Moi, j’aime bien The Thrills. D’une manière aussi sympa que tu pourrais aimer le petit frère d’un copain. (Sourire.) Vous voyez ce que je veux dire…
D : C’est bien, ces groupes, mais ils ne font rien avancer. Pour être franc, ça ne troue pas le cul. Tu l’écriras en français cette fois-ci. (Sourire.) Nous, on n’a jamais eu l’impression d’amorcer le retour de la pop californienne.
B : On n’a pas du tout réalisé notre premier album dans cet état d’esprit. C’est les gens qui nous ont parlé de références hallucinantes ou cauchemardesques, comme Prefab Sprout ou Steely Dan, deux formations qui nous touchent peu. D’ailleurs, je soupçonne certains de ne pas connaître ces groupes quand ils nous posent des questions. Je le vois dans leur regard. (Sourire.) On a déjà lu deux ou trois chroniques du nouvel album, qui évoquent encore ça…
T : Avec Alphabetical, on tenait à ce qu’il n’y ait aucune référence évidente.
D : Ce n’était pas le propos de ce disque.
B : Quand on a composé United, on avait envie d’un album intemporel, alors que le nouveau représentera sûrement plus son époque. On n’a plus peur du “démodable”. J’aime bien cette idée, finalement. Il faut vivre avec son temps. Tous les disques qu’on adore sont démodés. Les numéros de téléphone sont encore à quatre chiffres sur les pochettes…
T : Si on a choisi Tony Hoffer pour le mix, c’est d’abord parce qu’on le connaissait. On savait que c’était un mec bien. Et puis, il est hyper technique.
C : Ce n’était pas du tout pour le son de The Thrills, Turin Brakes, Air ou Beck qu’on a travaillé avec lui. D’ailleurs, Midnite Vultures est le disque de Beck qui sonne le moins bien. C’est juste que le courant passait bien entre nous.
B : L’important, c’est d’avoir des goûts communs en termes de son. Autant de choses qu’on peut difficilement expliquer à quelqu’un. Il faut que ce soit partagé dès le départ. Après quoi, on peut entrer dans les détails. Cet aspect est très important parce qu’il conditionne la texture d’ensemble du disque.
T : Tony aimait l’album tel qu’on lui avait apporté, c’est-à-dire presque produit. Il voulait s’impliquer dans un disque où il n’y avait quasiment plus que le mixage à réaliser.
B : Les Ricains ont quelque chose que les Européens n’auront jamais, c’est qu’ils sont entièrement à ton service. Ils ne foutent pas leur ego sur la table. Après vingt heures de travail, tu peux leur dire que c’est de la merde, ils recommenceront tout à zéro. (Sourire.) C’est vachement appréciable.
T : On est déjà quatre à donner notre avis, ce qui est déjà beaucoup. On n’avait donc pas besoin d’un ego supplémentaire.
B : Si on avait pu, on aurait aimé mixer l’album nous-mêmes. Mais c’est un boulot d’ingénieur du son. Et autrefois, ces mecs-là portaient des blouses blanches.
T : Dans le groupe, on fonctionne au veto. Il suffit d’un désaccord pour ouvrir un débat.
B : Entre nous, on a des désaccords majeurs, mais uniquement sur des points mineurs.Je n’ai jamais entendu ça de ma vie. On dirait Huey Lewis.
T : Avec un peu de la voix de Joe Strummer.
C : Ah, c’est les Clash ?! Pour le mélange sans les coutures apparentes, vous dites. Merci, c’est un compliment.
B : On voulait que Alphabetical soit plus rythmique que le précédent. Autrement dit, que la culture groove transparaisse naturellement. On a vachement travaillé pour trouver une sorte d’équilibre organique entre notre culture mélodique blanche et le côté Fela ou James Brown de l’Histoire. C’était très compliqué pour des blancs-becs comme nous. On a donc essayé de masquer les coutures.
T : De toute façon, l’envers du décor ne fait jamais rêver. Il n’y a que des batteries hybrides sur cet album.
B : Ça a été une grosse partie du travail de trouver le son de la rythmique. Il fallait qu’il soit à la fois instinctif et métronomique.
T : Prendre le meilleur des deux mondes. (Sourire.)
B : Au fond, tu peux juger un disque sur le beat. Il n’y a que ça qui compte. Le beat, c’est crucial. (Sourire.)
T : ça a donc servi de mettre la version démo de Everything Is Everything sur le single… D’ailleurs, c’est le tout dernier morceau qu’on ait fini.
B : On devient bons quand on se rapproche de la deadline, mais quand on s’en rapproche vraiment. (Sourire.) On n’arrive pas à ne pas travailler sur la corde raide. Par exemple, pendant qu’un titre était en train d’être mixé, on faisait simultanément l’introduction de ce même titre ! On a fonctionné ainsi pour à peu près l’ensemble des morceaux. (Sourire.) ça fait partie de notre tempérament.T : De qui est cette version ? Quel morceau génial…
C : C’était notre porte d’entrée pour les Beach Boys avec Don’t Worry Baby.
T : Il y a tellement de connections avec les Supremes et tous ces groupes soul.
B : Bon, c’est à moi de parler, je pense… (Sourire.) Eh oui, j’ai fait partie de Darlin’. J’ai rencontré Thomas (ndlr. Bangalter) et Guy-Manuel (ndlr. de Homem Christo) grâce à cette chanson. À la Danceteria, j’étais tombé sur une petite annonce de Guy-Man qui citait The Beach Boys et Spacemen 3 comme références. À l’époque, tout le monde se foutait de ce groupe et ne jurait que par la noisy pop. Je crois que c’est la raison qui m’a poussé à les appeler. On a toujours été attirés par l’attitude de francs-tireurs. Avec Darlin’, on faisait par exemple des reprises de Kiss, des choses qu’il ne fallait pas faire à l’époque. Ce n’était pas inscrit dans la Bible du parfait petit rocker. (Sourire.) On a enregistré le premier album de Phoenix avec en tête cette même idée de la marge et de la position d’outsider. Nos guitares ne collaient pas du tout avec l’air du temps de la french touch. Et finalement, on avait raison. Ce doit être un genre de culte de l’échec. Les Beach Boys sont tellement à l’intérieur de nos chromosomes qu’on n’y pense même plus. Ils ont formaté notre cerveau.
T : J’écoutais plus ça à l’époque du premier album, en dehors de la période où l’on a redécouvert Smile. On a acheté nos billets pour Brian Wilson à l’Olympia, mais on risque d’être en concert. Cela va être un moment très douloureux de les revendre.
D : Vous croyez que cela va être bien ?
T : J’ai de gros doutes.
B : Sinon, j’ai lu qu’ils allaient finir Smile, ce qui est, à mon avis, une idée pourrie.T : Quand on enregistrait l’album à Los Angeles, on écoutait KRS-101, une radio qui ne passe que des trucs comme ça. Si bien que tu as carrément l’impression de vivre dans les 60’s. C’est dément d’avoir l’impression de changer d’époque.
B : À la radio, le son est tellement énorme que tu crois entendre du hip hop actuel.
C : Du coup, Al Green sonne presque comme du Snoop Doggy Dog.
B : Avec les Américains, on partage le culte de la musique dans la bagnole. Le soir, on partait toujours en voiture écouter le mix de la journée, juste avant de le finir.
T : Là-bas, que tu sois au bord des palmiers ou en plein milieu du béton, tout fonctionne. Même quand il pleut à Los Angeles, ça marche encore. (Sourire.)
B : C’est comme si la qualité de l’air était différente et que les fréquences passaient autrement. Alors, t’achètes plein de skeuds, tu les écoutes en France, et ils deviennent pourris. (Sourire.)
T : Pour autant, ça nous serait impossible de vivre aux États-Unis. Tu deviens une loque. Pour bosser ponctuellement, c’est bien. Mais sinon, tu te vides. Si on habitait là-bas, on jouerait dans des clubs, on serait en short, un peu comme dans The Big Lebowski (ndlr. le film de Joel Coen, sorti en 1998). (Sourire.) Pour revenir à Heatwave, on nous avait demandé de faire une chanson rock pour la compilation Source Rocks.
B : Mais on ne peut pas s’empêcher de faire exactement le contraire de ce que l’on nous demande. (Sourire.) D’ailleurs, je me souviens d’une chronique incendiaire dans un magazine anglais de Dj’s, mais c’est une des plus jouissives que l’on ait jamais eue. Le journaliste avait adoré Heatwave, et avait écrit à propos de United qu’il s’agissait du changement de direction le plus débile depuis Spinal Tap. (Rires.)
T : Cette chronique nous brisait tellement qu’elle en devenait positive.
B : Le pire, ce sont les bonnes critiques qui n’ont rien compris. Et on en a eu un paquet. Bien qu’on essaie toujours de sortir des sentiers battus, on est souvent réduits à des clichés hyper cheap, genre trois lignes avec les mots Prefab Sprout dedans. La première fois, ça te fait marrer, mais au bout de la quinzième, il y a quelque chose d’atterrant dans un tel bâclage. On savait qu’on s’exposerait à des malentendus, mais on pensait qu’ils seraient plus fins.Broadway Project featuring Jeb Loy Nichols The Ballad Of Dorothy Parker
T : De qui est cette reprise ? Pas mal…
B : C’est le morceau ultime de Prince. D’ailleurs, il résiste à toutes les covers. On n’a toujours pas réussi à comprendre comment il fonctionnait ! Il est construit sur des accords qui sont toujours restés hyper mystiques pour moi. Et pour eux aussi, visiblement. (Sourire.)
T : Sur l’album Sign ‘O’ The Times, Adore est presque aussi incroyable que The Ballad Of Dorothy Parker. Pour info, le titre de notre album n’est pas un clin d’œil à Alphabet City. On y a pensé qu’après.
B : Il a été très important quand on était teenagers. Les années 80 ayant été la décennie la plus pourrie en termes de musique, il y avait heureusement Prince et quelques très rares trucs auxquels on pouvait se raccrocher.
T : En fait, Prince, c’est de l’éducation. À ses concerts, le public chante incroyablement juste. C’est rare.
B : Il nous a aussi éduqués dans le business. Voir qu’un mec comme lui pouvait être dans la merde avec sa maison de disques et n’arrivait pas à tout contrôler, ça a marqué les esprits. Aujourd’hui, savoir verrouiller ses rapports avec l’industrie est devenu un élément crucial.
C : Pendant nos deux années passés en studio, on a eu la chance de ne voir personne de notre label.
B : On sait que c’est un business, que les gens changent, s’en branlent, ou iront dans deux ans chez Universal. Il faut savoir s’en préserver. On a enregistré l’album de manière totalement indépendante. Et si on veut, on peut même s’autofinancer. L’indépendance artistique passe avant tout par cette indépendance-là. C’est un élément qu’a bien compris la nouvelle génération. Ça explique aussi en partie la merde dans laquelle se trouve le milieu aujourd’hui. Nous, on a un contrat qui nous permet de publier des disques sous nos propres noms, où l’on veut. Mais on s’en est encore jamais servi.Une reprise de Dylan, non ? ça me fait penser à un titre de Blood On The Tracks. T’as reconnu, Deck ?
D : La grille d’accords, mais pas le morceau. Le thème vient après ?
C : Ah, attendez… (Il chantonne.)
B : Il y a beaucoup de morceaux qui sont construits sur ces mêmes accords.
C : Mellow !
D : Ah, c’est Mellow sur la BO du film de Roman Coppola.
T : Roman est un mec qui te dit clairement que son cerveau est à ta disposition. Il te donne des idées jusqu’à temps qu’il y en ait une qui te plaise.
C : C’est le partenaire idéal, sans aucun ego. Il crée juste pour le plaisir. De toute façon, sa vie n’est que du plaisir. Il n’a pas besoin d’argent pour vivre.
T : On l’a rencontré via le clip de Playground Love (ndlr. la chanson du film The Virgin Suicides). Ensuite, il a réalisé la vidéo de Funky Square Dance et de notre nouveau single, Everything Is Everything.
B : ça revient toujours à la même idée : on fonctionne sur le mode des affinités électives et des rencontres. Ça ne nous intéresse pas de travailler juste avec un nom. Il y a toujours beaucoup de gens pour te conseiller de choisir le “meilleur mec du moment”. (Sourire.)
C : Pour le clip de Run Run Run (ndlr. le premier single d’Alphabetical en Angleterre), on nous avait proposé un mec qui a bossé pour Beyoncé et Madonna. Mais on a préféré choisir un pote, Mathieu Tonetti, qui avait déjà réalisé la vidéo de Universe de Sébastien Tellier.
B : On aime bien que les choses se passent naturellement. De toute façon, toutes les décisions prises sont de notre ressort.Tu reconnais directement la guitare.
T : C’est Louis… (ndlr. Bertignac) Vous voulez qu’on parle des Victoires de la Musique ?
B : Le succès de Carla Bruni me fait plutôt plaisir. Il y a une honnêteté assez irréprochable.
C : On s’est toujours senti à part en France. ça ne nous a jamais touchés que les charts soient si pourris. C’est un autre monde, assez inoffensif.
B : Mais ça, c’est pas pourri ! Les gens ne sont pas idiots. Ils sentent quand il y a un truc qui veut dire quelque chose. Carla Bruni, ça a un sens pour eux. Et c’est bien que ça marche, même si c’est pas un disque que j’écoute chez moi.
T : J’ai failli être surpris. (Sourire.)B : C’est Étienne, non ? Lui aussi a toujours été en marge, en gardant le cap. Au final, ça paye. Ça a l’air simple de rester classieux, mais c’est très dur de tenir son cap. En France, il y a peu de personnes qui ont réussi à rester aussi intègres que lui.