Dans le numéro #211 de Magic !, nous avions consacré un article à des chanteurs français (Bertrand Belin, Dominique A, Mathias Malzieu) qui ont franchi le pas de la chanson à la littérature, et ont publié des romans. En complément de cet article voici l’interview intégrale de Bertrand Belin. Quelles relations noue-t-il, tisse-t-il, entre l’écriture de chansons et celles de romans ? Réponses (longues et passionnantes) à mots choisis.
On connait Bertrand Belin musicien, frère de langue de Bashung pour l’art de l’ellipse, la clarté et la distinction du chant, le sens redoublé par l’articulation, enrichi par la retenue. De La Perdue (2007) à Cap Walter (2015), le breton s’est imposé en cinq albums comme une figure majeure du rock français, un rock nourri à celui, tranchant et minimal de l’Amérique des années 1950, mais que d’aucuns ont pu qualifier de « lettré », nourri de lectures revendiquées (Jaccottet, Tarkos, Echenoz, Borges), grisant les mélodies de poésie concise, esthète. En 2015, sous l’impulsion amicale de l’écrivain Éric Reinhardt, Bertrand Belin voit son premier roman, Requin, publié par la maison d’édition P.O.L.
Dans Requin, un homme se noie – une crampe à la jambe – dans le contre-réservoir de Grosbois, un lac artificiel des environs de Dijon. Tandis qu’il se débat, se sachant mourir, l’homme« pense à tout sauf à mourir » et voit sa vie (et ses erreurs, sinon ses fautes) défiler, de l’enfance à cet instant fatal, en un ultime « numéo de claquette d’un foutu », ou une sorte de comparution, « jugement dernier » dont il serait le seul juge. Entre mélancolie et ironie, Bertrand Belin sculpte ce récit introspectif et terminal en esthète des mots, déployant plus largement son écriture, comme une extension vers le monde concret de celle, plus elliptique et métaphorique, de ses chansons.
Après Requin, P.OL. sort en 2016 Littoral, court récit évoquant une autre forme de noyade, politique et sociale cette fois. Bertrand Belin y marie les souvenirs de son enfance à Quiberon, dans une famille où son grand-père, son père, ainsi que deux de ses frères ont été pêcheurs sur des chalutiers, à une évocation de l’Occupation (sous toutes ses formes) et des modifications qu’elle instille peu à peu dans les cœurs et les corps. Le plaisir du lecteur y est redoublé par l’utilisation du vocabulaire technique des marins (« Mettre les chapeaux sur les vifs », « Donner un coup de jet sur le billot » « Vider l’eau des bacs à lançons »), souvent abstrait, étrange, mais sonore, évocateur, riche d’inconnus et de possibles. L’écriture de Belin y est plus ramassées, concise, ciselée. Elle a grandi, elle s’affine. Voilà l’intégralité des réponses que Bertrand Belin nous a envoyé à propos de son activité de romancier, pour le #211 de Magic !
Qu’est-ce que l’écriture d’un roman nécessite comme forces, travail, manières de travailler, et en quoi cela diffère (ou se rapproche) de l’écriture d’une chanson ?
Bertrand Belin : Il me semble que la contrainte majeure en ce qui concerne la chanson consiste en sa durée imposée par les usages. Une durée brève souvent, très brève parfois. L’autre contrainte évidente, c’est ce que la musique (rythme, mélodie, arrangement) peut prendre à sa charge en terme de dramaturgie et qui par conséquent doit idéalement être retranché du texte lui-même. L’idée que le ton, la voix, l’oralité, représentent l’horizon fatal d’un texte écrit pour une chanson me conduit par ailleurs à considérer l’emploi de la voix comme le signe d’une plus grande implication de l’intime. Je suis certain en ce qui me concerne que cela peut occasionner de la pudeur et donc de la retenue. Intégrer, retourner cette pudeur et cette retenue pour les changer en ingrédients non silencieux de mes chansons, voilà un enjeu pour moi fondamental. Lorsque j’écris des textes non destinés à être mis en musique et chantés, je ne parle par conséquent pas tout à fait du même endroit. J’ai le temps de dire et de contredire, d’argumenter et de nuancer. Je peux être plus aventureux aussi dans la spéculation, faire usage de mauvaise foi. Fabriquer des dispositifs dramatiques dont le fonctionnement ne peut se passer du temps long de la controverse argumentée ou d’autre type de bazar rhétorique. La chanson est un canif de poche, le roman un service complet avec louche, fourchette à poisson et tout l’attirail.
Beaucoup de tes chansons ressemblent à des allégories, où la « journée », la « maison », le « cap », sont des notions (quoique certainement liées à ton histoire personnelle) rendues abstraites, universelles, et « habitables » par n’importe quel auditeur (la journée sera la vie, la maison sera la Terre, le cap sera un âge de la vie). Est-ce qu’on pourrait voir tes romans comme des développements, voire des éclaircissements de ces allégories ? Une manière d’ancrer ces idées abstraites dans la réalité, la vie, la durée plutôt que l’instant ?
Il est vrai que dans mes chansons, les lieux, les choses ainsi que les personnages, souvent des silhouettes, ne sont jamais approchés de trop près. Je suppose que la formation d’une image mentale repose sur la possibilité de projeter sur un récit fait de formes génériques, les détails d’une expérience intime. Si on me parle d’une maison, ou encore d’un type se tenant debout sur une place, ma représentation diffèrera de celle de mon voisin suivant la convocation de souvenirs particuliers intégrant ces éléments. Lorsque j’écris une chanson, je tiens compte de la capacité de celui ou celle qui l’écoutera d’en parachever l’écriture en y projetant ces représentations. Il faut pour cela avoir ménagé de l’espace. Écrire un roman est pour moi l’occasion de faire apparaître le grouillant multiforme et profus du réel en plus des réactions, pensées, actions, des corps et des esprits plongés dedans ; de rompre avec le principe d’économie, voire de rigueur que la chanson implique. Il est donc bien question d’un besoin de développement de ce qui se joue dans mes chansons, mais aussi de débordement, de crue, du recours et de l’usage jouissif de tout ce que la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe offre comme moyen d’élucidation et de perdition. Je ne vois pas le rapport entre mes chansons et mes livres selon une dialectique abstrait / concret mais selon l’opposition indiscret / discret. Chanter avec son larynx, ses yeux, ses mains, c’est imposer une présence au monde. L’additionner au monde. Écrire dans la solitude pour être lu dans le silence est une forme de soustraction au monde au profit de l’écriture.
Il y a d’ailleurs presque un jeu de pistes entre tes romans et tes chansons, avec des allers-retours de mots (« Peggy », « Requin »), de situations (« l’étang, la fille, le bain ») et de thèmes (la solitude – l’isolement -, d’un homme au milieu d’une étendue d’eau, déserte, ou sous le soleil). Est-ce que l’écriture des romans a parfois nourri celle des chansons ? Et réciproquement (la musique enrichissant les mots de sensations, d’émotions ?) ?
Les relations entre mes chansons et mes livres sont jusqu’à présent constantes. Mêmes préoccupations : déclassement, effacement, continuité du temps et du lieu, permanence du minéral, solitude, humour absurde, clins d’œil métaphysiques. Je ne dirais pas que les deux s’alimentent l’un l’autre mais qu’ils sont alimentés par la même source. Cette source est un assemblage en moi des observations du citoyen et de l’ermite. L’espérant et le désespérant.
“Sans les territoires immenses que peuvent ouvrir l’harmonie, le rythme, la mélodie, la production et ses effets, la nostalgie ne serait que regret stérile et perte de temps.”
L’écriture romanesque serait donc moins elliptique, suggestive, que celle des chansons. Mais tout aussi ciselée, travaillée, et on y sent peut-être d’avantage l’amour des mots, le rythme des mots seuls. Est-ce qu’il y a un plaisir particulier de l’écriture romanesque, de la phrase, de la durée, de la construction ?
Je retire de très grandes satisfactions de la construction d’une phrase, de l’humour qui peut se dégager de sa seule « tournure » en dépit de l’absence de propos comique. Le temps long de l’écriture romanesque est plus favorable à l’apparition de tel fragment de langue. La grammaire en elle-même, la syntaxe, produisent des trésors inestimables. Je pense aux mathématiciens qui disent pouvoir s’extasier devant des équations, des édifices, des agglomérations de concepts faramineux. Lorsque je débusque ce que je considère comme des trésors avec le moins de ressources possible (deux mots par exemple) c’est le nirvana. Il me semble que c’est plus difficile dans le temps court de la chanson, mais aussi plus gratifiant.
Je le trouve redoublé (ce plaisir, en tant que lecteur) dans l’utilisation du vocabulaire technique des marins dans Littoral, très abstrait, étranger, mais du coup évocateur, riche d’inconnus et de possibles. Est-ce un vocabulaire documenté, fidèle à la réalité, parfois inventé (?) ou, sachant que ton père était marin, est-ce un vocabulaire que tu as appris de ton enfance ? Et, à ce propos, à quel point est-ce là un portrait de ton père (si tu veux en parler) ?
Littoral est un récit imaginaire dans la trame duquel se sont invités des éléments biographiques. La figure du père -salaud-héros- et son cortège de dilemmes moraux proviennent en effet de mon expérience d’enfant et d‘adolescent. La question des origines et du caractère adhésif du passé est partout dans mon écriture. Ce n’est pas une méthode bien entendu et c’est peut-être même handicapant, mais c’est bien avec ma perception de ma vie d’alors que je lis le monde d’aujourd’hui. L’écriture romanesque me permet de corriger cette situation en m’obligeant à regarder le monde autour de moi, à lui faire face, à en répondre dans la netteté du présent. La nostalgie est une figure traditionnelle de la chanson. Sans les territoires immenses que peuvent ouvrir l’harmonie, le rythme, la mélodie, la production et ses effets, la nostalgie ne serait que regret stérile et perte de temps. La chanson est le lieu possible de l’expression d’une incertaine nostalgie.
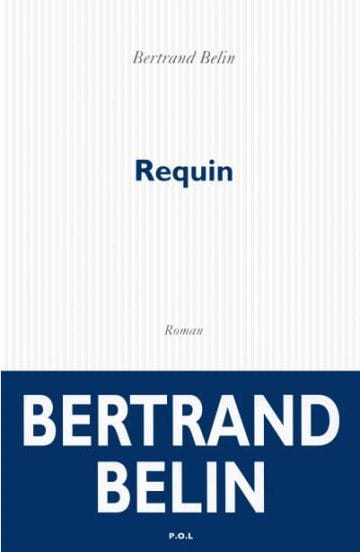
Requin et Littoral mettent tous deux en scène un homme seul au milieu d’une étendue d’eau (se noyant, ou abandonné sur une balise) et cet isolement est aussi un moment de compréhension, un révélateur, une initiation (même tardive). Comme allégorie, Requin peut ainsi évoquer une sorte de « jugement dernier », où le personnage voit sa vie (et ses erreurs, sinon ses fautes) défiler. Littoral, d’une autre manière, confronte un homme à la justice (ou l’injustice) des hommes, dans une société sous le joug « d’un pays » et de son armée, auquel cet homme a, un instant, résisté. Dirais-tu que tes deux romans sont porteurs d’une morale, à propos de la vie juste, de l’action juste, et des conséquences de nos actions ? Une morale existentielle pour Requin, une morale plus politique pour Littoral ? Qu’est-ce qui t’orienterait vers cette thématique presque « camusienne », selon toi ?
Ce qui me pousse à aborder la question de la responsabilité des actes et des paroles d’un individu, c’est la nécessité de comparaitre moi-même. D’extérioriser le forum intérieur afin d’instruire à vue mon propre procès. De quoi je me sens coupable ? De ne penser qu’à moi (en résumé). Tout le monde meurt un jour, mais surtout moi, dit l’estomaqué. Je ne me condamne pas pour cela bien sûr, mais se questionner à ce sujet est un minimum : Que puis-je pour autrui ?
Dernière question : À quel moment as-tu souhaité « entrer en littérature », c’est-à-dire, proposer un manuscrit à un éditeur ? Comment s’est passé ta rencontre, puis ta collaboration avec Paul Otchakovsky-Laurens ? Veux-tu dire quelques mots sur lui, qui est récemment décédé, et sur ce qu’il t’a apporté en tant qu’écrivain ?
J’écris depuis l’adolescence. Jusqu’à Requin, aucun texte ne m’avait paru susceptible d’intéresser quiconque. Mon ami écrivain Éric Reinhardt auquel j’avais fait lire Requin m’a imposé fraternellement de l’adresser lui-même aux Éditions POL. Il savait bien entendu que là était d’ailleurs mon rêve sinon mon projet. Seulement, je n’osais pas trop. Son insistance a été capitale. Sans quoi ce manuscrit serait encore quelque part dans un tiroir. Au bout de quelques mois, ne recevant pas de nouvelles, je me suis décidé à adresser une lettre à Paul-Otchakovsky-Laurens. Celui-ci m’a répondu rapidement et nous avons convenu d’un rendez-vous aux bureaux des éditions POL. J’y suis arrivé fébrile. J’en suis ressorti envivanté. Personne, jamais, ne m’avait réservé un accueil si subtil. Paul-Otchakovsky-Laurens m’a définitivement marqué. Nous-nous sommes toujours vouvoyés. Je l’aimais et l’admirais. C’était un très grand mélomane. Il venait aux concerts que je donnais à Paris. Je pense à lui tous les jours.
Entretien : Wilfried Paris
Photo : Cédric Rouquette


