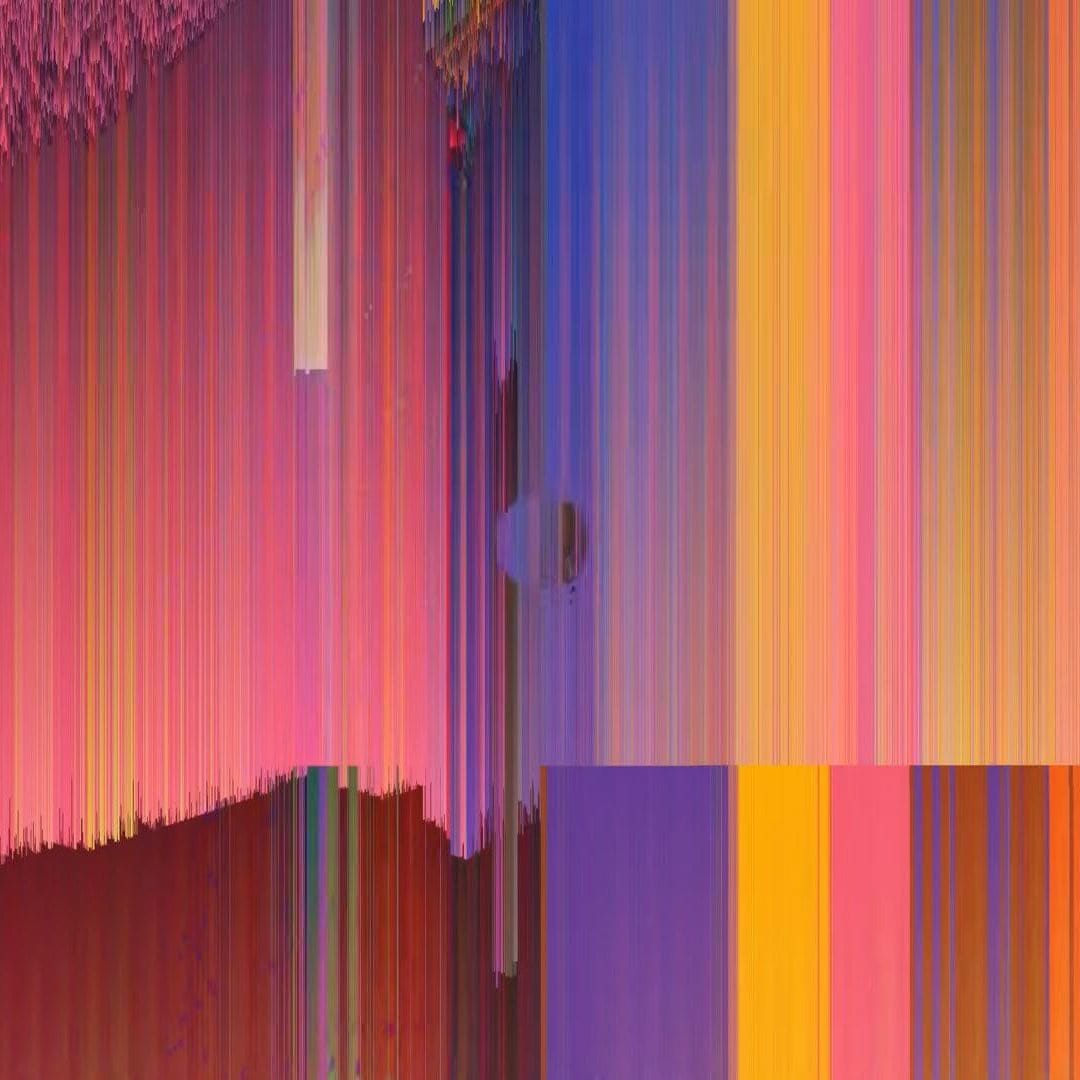“I will be gone but not forever”, chante Jason Molina sur le morceau Farewell Transmission de Songs: Ohia. Implacable intuition. Cette voix puissante et douce qui semblait déjà revenir d’un lointain passé nous parle encore aujourd’hui. Elle n’est pas près de s’éteindre. Il y a des albums que l’on peut entendre une seule fois mais qui résonnent ensuite toute une vie en nous. Magnolia Electric Co. (2003) est l’un des derniers grands disques, tout court. Bouclant une époque et une génération. Il faut se remémorer à quel moment ce coup de tonnerre s’est fait entendre. À l’orée des années 2000, on avait encore nos habitudes chez notre disquaire. On pouvait sortir de son lit un matin robuste et glacial de février pour aller chercher un CD de The For Carnation qu’on avait commandé depuis des lustres. Ce n’était jamais un effort, plutôt une nécessité. Tout relevait de la quête, une sorte de tourbillon où se mêlaient frustration et la plus incroyable des patiences. On prenait du temps pour chercher, trouver et écouter une œuvre. Certains d’entre nous traquions dans les rayons de rock indépendant des équivalents aux chefs-d’œuvre de Neil Young, After The Gold Rush (1970) et Zuma (1975). Sorte de Graal intime, ces deux essais du Loner ont fasciné plus d’une génération. En découvrant Viva Last Blues (1995) de Palace Music, certaines chansons de Smog ou Silver Jews, il y avait derrière, toujours, After The Gold Rush et Zuma. La seconde partie des années 90 fut une période très riche et particulièrement émouvante concernant ce type de songwriting. Durant cette fastueuse parenthèse, Songs: Ohia a souvent évolué dans l’ombre de Will Oldham.
Les plus ingrats écoutaient les disques de Jason Molina simplement pour attendre le prochain Palace. Les plus mélomanes avaient déjà saisi l’aspect unique et très personnel de la musique de Songs: Ohia. Une nuit de déconfiture sentimentale, j’avais attendu l’aube en écoutant une seule chanson, Defenders. Une fiévreuse rengaine crépusculaire sortie de ce bouquet d’étincelles qu’est Hecla & Griper (1997). Molina avait dans sa voix cette précieuse note bleue, celle qui nous pousse à de longues discussions avec la mort, avec nos amours improbables et nos douloureuses addictions. Par exemple, Axxess & Ace (1999) est à écouter en fin d’après-midi hivernal, quand l’horizon marque ses premières tristesses. Quant à The Lioness (2000), Étienne Greib avait noté dans ces colonnes l’indication suivante : “Un disque qu’il faut écouter sous la tempête pour vraiment comprendre le sens du mot dépression.” Rien à ajouter. On ne va pas passer en revue toute cette fabuleuse discographie, on vous demandera juste d’aller acheter les disques. Pour leur beauté, pour la mémoire d’un artiste unique. En entendant pour la première fois Magnolia Electric Co., j’étais lassé des dernières compositions de Will Oldham, la source se tarissait, quelque chose finissait – une frénésie, une passion et une manière de penser la musique. Tout s’émoussait fatalement. Rain On Lens (2001) de Smog ? Un cheval ombrageux en bout de course. Ease Down The Road (2001) de Bonnie “Prince” Billy ? Un disque blindé d’arthrose. C’est donc dans ce creux de la vague, dans ces instants partagés entre lassitude, déception et métamorphose que Jason Molina publia son plus bel album avec Songs: Ohia. Une évidence. Le beau bleu et noir de la pochette ; la foudre qui s’abat, la minuscule larme qui glisse le long de la tête de cette chouette belle comme une pietà et cette fleur de magnolia… Taillée, mutilée et dressée devant l’oiseau de nuit – une fleur droite comme une croix. Toutes les obsessions de Molina figurent sur ce disque : la nuit, la lune, le bestiaire qui va avec l’astre mort, le désespoir et la lumière.
Jason Molina a dressé ses angoisses d’une main ferme et avec le plus sombre des fouets – l’alcool. “Beau comme le tremblement des mains dans l’alcoolisme”, disait Lautréamont. Les doigts du chanteur n’ont jamais failli au moment de composer cette suite de classiques. Des titres troublés et vacillants entre Zuma et Tonight’s The Night (1975). Le morceau d’ouverture Farewell Transmission nous fait chialer avec tout un mur d’électricité, grand moment de crescendo haletant. “Listen!”, nous indique l’Américain à la fin de la chanson. On écoute, on écoute. Suit l’un des titres les plus envoûtants et habités du répertoire de Jason Molina, I’ve Been Riding With The Ghost. Les chœurs bleu-nuit, les cisailles portées par les guitares électriques, le tempo battant le galop – tout est assemblé remarquablement. Steve Albini a déclaré que ce qui le fascinait le plus chez Molina, c’était cette manière immédiate qu’il avait de composer et d’enregistrer en une ou deux prises. Un Orphée mélancolique, butinant maladivement son ivresse sur les longues routes traversant le pays, composant une chanson décisive entre un hôtel sordide et le plus incroyable des levers de soleil. Just Be Simple et Almost Was Good Enough semblent sortis tout droit des forges du Crazy Horse. Chansons jumelles, fondues d’un même métal éclatant, elles creusent un sillon nommé Neil Young. Brutalement, Magnolia Electric Co. devient un disque de rencontres et de voix multiples : The Old Black Hen est interprétée par la voix grave de Lawrence Peters. Sorte de ballade immémoriale, elle est le premier contre-feu de l’ensemble. Le changement de chanteur et d’orchestration trouble l’auditeur, le bouscule.
Scout Niblett avec sa voix blanche apparaît comme une revenante sur Peoria Lunch Box Blues, une composition d’une intensité saisissante qui vient égratigner le calme apparent de The Old Black Hen. Des entités étranges qui sont comme deux âmes fragiles, coincées dans un tumulte immense et majestueux à la fois. Cette pause fait réapparaître le tonnerre : John Henry Split My Heart. Les guitares cognent et grésillent de nouveau sous une rythmique agressive. Cet embrasement retrouvé est une merveilleuse introduction au titre de clôture, Hold On Magnolia. Car le final de Magnolia Electric Co. est un moment inoubliable. Rarement la tristesse, la douceur et la douleur ont été à ce point retranscrites en musique. Le chant de Molina est d’une vérité crue… On entend la vie et la mort balancer d’un couplet à l’autre. Essentiel. Un titre que l’on étreint encore plus depuis la disparition de ce prodigieux type qui nous manque déjà trop. Secretly Canadian, pour le dixième anniversaire de la parution de ce chef-d’œuvre, fait les choses impeccablement. Deux inédits viennent compléter l’affaire. The Big Game Is Every Night est un équivalent de Sad Eyed Lady Of The Lowlands de Bob Dylan, cette splendide pièce à rallonge qui conclue Blonde On Blonde (1966). Un grand fleuve couleur nuit. Autre inédit, Whip-Poor-Will voit Molina partager magnifiquement son chant avec quelqu’un d’autre. Le deuxième disque est bien connu des fans, il s’agit des démos de l’album. Beautés brutes, rares et uniques. Assemblées comme de douces prières, elles ferment peut-être ce lourd volume qu’est Magnolia Electric Co. mais elles incitent surtout à faire revenir encore et toujours le chant de Jason Molina. “I will be gone but not forever…”